Au XIXe siècle, la photographie est une technique accessible uniquement aux classes aisées de la société. Au fil des décennies, les tirages photographiques se transforment en un moyen de communication efficace et apprécié : dans le domaine touristique, la carte postale s’impose rapidement, un carton rectangulaire portant d’un côté une image et de l’autre…
L’émergence de la carte postale à l’ère de la photographie élitiste
Au XIXe siècle, la photographie représente une technologie complexe et coûteuse, accessible exclusivement aux classes sociales privilégiées. Comme le documente Susan Sontag dans On Photography (1977), la photographie du XIXe siècle requiert des compétences techniques spécialisées et un équipement onéreux, s’imposant d’abord comme une pratique distinctive de l’aristocratie et de la bourgeoisie émergente.
Dans ce contexte socio-technologique, les tirages photographiques évoluent progressivement de curiosités élitaires en outils de communication de masse. La carte postale illustrée apparaît comme un format révolutionnaire : un support cartonné rectangulaire qui combine l’immédiateté visuelle de l’image photographique avec la fonctionnalité communicative du message écrit. Selon les recherches d’Orvar Löfgren (2001), la première carte postale illustrée d’une photographie remonte à 1889, proposée à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, immortalisant de manière significative la tour Eiffel, symbole architectural de l’événement et paradigme de la modernité industrielle.
L’iconographie standardisée du tourisme de masse
La seconde moitié du XXe siècle marque une transformation capitale : le tourisme se démocratise, évoluant de privilège élitiste en phénomène de masse planétaire. Comme l’analyse John Urry dans The Tourist Gaze (1990), cette massification entraîne la standardisation de l’expérience touristique et, par conséquent, de sa représentation visuelle.
L’avènement de l’ère fordiste et la démocratisation des pratiques touristiques conduisent à l’affirmation d’une iconographie codifiée, résumée par la formule des « 4S » : Sea, Sand, Sun and Sex. Cette standardisation iconographique reflète ce que Dean MacCannell (1976) définit comme la staged authenticity : l’authenticité locale est progressivement remplacée par des représentations homogénéisées répondant aux attentes touristiques mondialisées.
Les cartes postales de cette période témoignent de l’émergence de l’héliotropisme comme paradigme dominant. Les destinations balnéaires comme montagnardes adoptent un langage visuel centré sur la centralité du soleil, élément unificateur de l’imaginaire touristique standardisé. Cette homogénéisation iconographique reflète des processus plus larges de mondialisation culturelle analysés par Roland Robertson (1992) dans le concept de glocalization.
La diversification postmoderne et la révolution numérique
Les années 1990 du XXe siècle marquent un tournant significatif : la fragmentation croissante des marchés touristiques favorise l’émergence des « tourismes de niche ». Comme le documente Poon (1993) dans Tourism, Technology and Competitive Strategies, cette diversification répond aux besoins de segments de marché toujours plus spécialisés et en quête d’expériences authentiques et personnalisées.
La véritable révolution est représentée par l’explosion des réseaux numériques, en particulier d’Internet. L’avènement des technologies digitales redéfinit radicalement les paradigmes de communication touristique. La carte postale traditionnelle, tout en conservant une présence symbolique dans l’imaginaire des vacances, doit se confronter à de nouvelles formes de communication : SMS, MMS, cartes postales virtuelles, blogs et publications en ligne redessinent les modalités de partage de l’expérience touristique.
Comme l’observent Sheller et Urry (2006) dans le concept de mobile turn, la communication touristique devient instantanée, interactive et multimédia, dépassant les limites spatio-temporelles de la carte postale traditionnelle. La numérisation n’élimine pas la fonction communicative de la carte postale, mais en transforme profondément les modalités et les significations, l’inscrivant dans un écosystème médiatique plus complexe et articulé.
Sources
MacCannell, D. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. University of California Press.
Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies. CAB International.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Publications.
Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38(2), 207-226.
Sontag, S. (1977). On Photography. Farrar, Straus and Giroux.
Urry, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. Sage Publications.
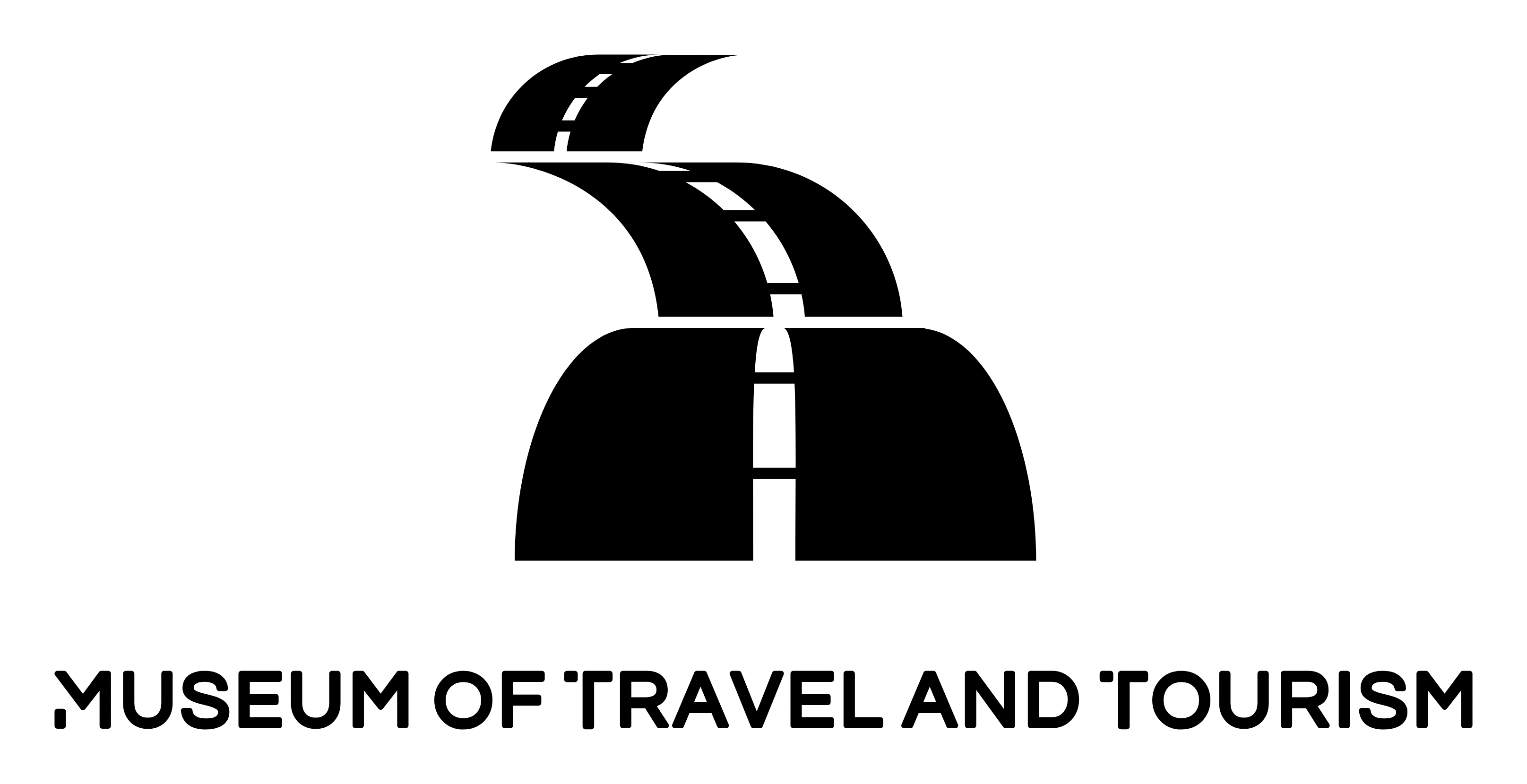
 Français
Français  Italiano
Italiano  Deutsch
Deutsch  English
English 